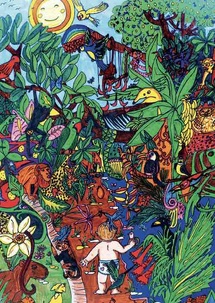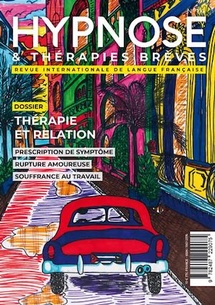Dans l’approche interactionnelle et stratégique, la prescription de symptôme est une intervention thérapeutique de type paradoxal dont les variantes sont nombreuses... et toujours surprenantes. Dans cet article, je souhaite vous présenter une forme qu’il nous arrive souvent de prescrire à des parents d’enfants de tous âges qui consultent pour des problèmes récurrents, douloureux mais finalement très communs d’escalade symétrique, de disputes, de crises, des problèmes capables de mettre à mal la relation avec leurs enfants mais aussi de déteindre sur l’équilibre de toute la famille. Cette prescription, tout efficace qu’elle puisse être, est assez délicate à appliquer et il faut s’assurer que la personne qui consulte l’ait bien comprise, de sorte qu’elle puisse l’appliquer à bon escient pour en retirer tous les bienfaits... et retrouver davantage de paix dans la relation. Pour l’illustrer, trois histoires...
HISTOIRE DE CLAUDINE ET CHARLOTTE
Claudine, maman de deux filles respectivement âgées de 9 ans et de 6 ans, appelle pour prendre rendez-vous pour sa deuxième fille, Charlotte. Motif : « Charlotte, raconte Claudine, a un sacré cabochon, et lorsqu’elle n’est pas contente, elle peut hurler pendant longtemps. » Elle s’oppose fréquemment aux décisions des membres de sa famille, ce qui lui donne autant d’occasions de crier. Je lui demande tout de suite si Charlotte se plaint elle-même de quelque chose. « Absolument pas, répond Claudine. C’est pour nous (les trois autres membres de la famille) que c’est difficile. » Décision est prise de voir les parents seuls, dans le but de les outiller et de les embaucher « comme co-thérapeutes » afin d’aider leur fille. C’est ce que nous appelons une « thérapie indirecte », que nous pratiquons avec les personnes qui souffrent d’un problème et qui sont mobilisables lorsque le patient désigné ne veut pas ou ne peut pas venir consulter. J’ai choisi de vous présenter le cas de Claudine car il a une originalité : les parents (surtout la maman) se veulent compréhensifs, à l’écoute, leur éducation doit être positive ; une confrontation un peu énergique avec sa fille lui est impensable car assimilée à de la brutalité. Elle cède dans la plupart des cas, lorsqu’elle considère qu’elle peut laisser sa fille faire comme elle veut, mais tient bon parfois lorsqu’elle décide qu’elle n’a vraiment pas le choix.
Concrètement, lorsque Charlotte est mécontente, par exemple de devoir marcher dans la rue pour aller à un endroit où elle ne veut pas aller – comme à la bibliothèque pour rendre les livres empruntés –, elle hurle tout ce qu’elle peut tandis que sa mère (ou parfois son père) la traîne pour qu’elle avance. La dernière fois, elle s’est égosillée pendant vingt minutes, puis s’est plainte d’avoir mal à la gorge. Les passants la regardent, font parfois des commentaires, mais elle est dans sa bulle et ne semble pas en être affectée. Dans la plupart des familles, généralement, les tentatives de solution des parents consistent à ordonner à l’enfant de se taire puis à exploser dans une escalade symétrique lorsqu’ils n’en peuvent plus, ou alors à céder par lassitude et souvent par honte devant le regard d’autrui. Mais pas Claudine. Elle a compris qu’être frontale avec sa cabocharde de fille ne sert à rien, elle ne veut pas lui faire du mal psychologiquement, alors elle se tait, la tire effectivement pour la faire avancer tandis que la petite crie à qui mieux mieux jusqu’à ce qu’elle soit distraite par autre chose et arrête de crier.
Claudine raconte tout cela de manière assez placide, mais lorsque j’approfondis un peu elle avoue qu’elle est « fortement agacée ». Fortement agacée, mais elle ne dit rien. Et maintenant, il faut rejoindre Claudine, soigner la relation avec elle, lui faire sentir qu’elle a été entendue et comprise quant au problème pour lequel elle consulte, tout en commençant à intervenir sur sa perception : car nous devons guider la personne de manière à ce qu’elle fasse un 180 degrés par rapport à ses tentatives de solutions, c’est-à-dire carrément le contraire de ce qu’elle faisait jusqu’à présent et qui ne fonctionnait pas. Nous devons la rejoindre, l’accompagner et la conduire (« pacing and leading », comme le disait Milton Erickson), et dans cette communication le savoir-faire hypnotique a toute sa place. Je demande à Claudine :
- Thérapeute : « Pensez-vous que Charlotte n’a pas capté votre agacement ?
- Claudine : Si, si, elle l’a capté, même si elle est complètement dans son truc quand elle crie pendant si longtemps. En même temps, je ne vais pas l’empêcher d’exprimer son ressenti... J’ai une image de la petite Charlotte toute seule « dans son truc », dans sa transe de contrariété, de colère et de douleur.
- Th. : Non, non, bien sûr que non. Mais récapitulons un peu : Charlotte est contrariée, très contrariée, elle l’exprime, pour l’exprimer elle peut crier dans ce grand vide sidéral où personne ne lui dit rien, où finalement elle est prise dans sa colère, toute seule avec elle-même tout en étant dans le monde parmi les autres, et par ailleurs même si vous ne lui dites rien, elle sent bien que vous êtes agacée, que cela ne vous convient pas, finalement. Pour le dire autrement, d’un côté elle peut crier, de l’autre elle sait que cela ne vous va pas... »
En effet, comme nous l’a appris Paul Watzlawick, « on ne peut pas ne pas communiquer »... Nous voyons qu’à ce stade, en terme de dynamique interactionnelle, nous n’avons pas de franche escalade symétrique, où les deux protagonistes se livreraient à un bras de fer doublé d’une réelle dispute, mais nous n’avons pas non plus une franche relation complémentaire, où l’un des deux céderait au bénéfice de l’autre. C’est une symétrie plus larvée, où la maman tient son objectif mais ne dit rien car elle ne veut pas tomber dans le piège de forcer sa fille à ne pas crier, et où la fille fait à sa manière les pieds au mur mais où elle n’a pas d’autre choix, semble-t-il, que de crier jusqu’à n’en plus pouvoir. La maman a fait un choix éducatif plus permissif, dirions-nous, mais elle se tait. Et elle communique malgré elle un agacement, un « j’aimerais que tu te comportes autrement », et on la comprend ! On pourrait dire que ce qu’elle a mis en place, c’est quelque chose à mi-chemin entre la tentative de solution classique de l’escalade symétrique qu’elle veut éviter, et un 180 degrés accompli. Elle est coincée dans le dilemme suivant : « comme il est hors de question que je crie moi-même alors que ma fille crie, je me tais (mais ça n’est pas satisfaisant) ».
Nous sommes dans une relation complémentaire problématique car en contradiction avec ce qu’elle pense : « Si seulement elle pouvait ne pas crier ! » Ce qui représente tout de même une escalade symétrique. Et comme elle ne peut pas toujours laisser sa fille faire ce qu’elle veut (par exemple, la laisser seule dans la rue), elle la tire tandis que la petite résiste en criant (mais ça n’est pas satisfaisant non plus). Là aussi, nous avons une escalade symétrique. Telle est la dynamique interactionnelle du problème, sur laquelle nous allons calquer la dynamique interactionnelle de la solution de manière à faire vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qui n’a pas fonctionné. Voici donc la prescription thérapeutique telle qu’elle a été donnée à Claudine :
- Th. : « Comme nous l’avons vu, Charlotte sent que vous espéreriez qu’elle se comporte autrement, mais comme elle est contrariée – et fâchée contre vous –, elle n’est pas près de vous faire ce plaisir. En même temps, il semble qu’elle puisse se retrouver comme coincée dans cette émotion de grande contrariété qui l’oblige à hurler dans la durée, jusqu’à en avoir mal à la gorge, mais c’est comme si elle n’avait pas d’autre choix pour le moment. Je voudrais vous proposer une alternative, une indication très bien traitante et bienveillante qui à mon avis coche toutes les cases de ce qui est important pour vous – et pour moi. Cette alternative, en essence, va communiquer à Charlotte : “tu as le droit d’avoir des émotions, tu as le droit de les manifester, je t’en prie fais-le, et cela me va tout à fait, je n’en suis pas incommodée.
Mais nous allons tout de même faire ce que j’ai prévu qu’on fasse”. Concrètement, voici ce que cela peut donner : “ma chérie, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire, et tu vas certainement avoir envie de crier, je t’en prie si ça te fait du bien n’hésite pas à crier autant que tu le peux pendant que nous marchons, car nous allons aller rendre les livres à la bibliothèque”. Alors vous comprenez que si Charlotte crie tant qu’elle peut, elle vous aura obéi, n’est-ce pas, et nous serons contentes qu’elle vous ait obéi ! Et si au contraire elle ne crie pas, mettons qu’elle vous regarde bizarrement ou se mette à bouder mais ne crie pas, elle vous aura désobéi mais nous serons contentes aussi, n’est-ce pas ? Tout le monde sera gagnant. Et bien sûr vous ne lui direz pas : “tu vois, quand tu veux, tu peux être sympa !”. Donc, qu’elle crie ou qu’elle ne crie pas, qu’elle vous obéisse ou qu’elle vous désobéisse, tout le monde sera gagnant et elle aura eu de vrais choix. Car vous savez, c’est très différent pour un enfant de crier de manière interminable, sans l’avoir vraiment choisi mais sans pouvoir faire autrement, et de crier parce que sa mère le lui a demandé.
Là, ce sera vraiment une décision. Dans ce dernier cas, si elle crie, alors vous devrez attentivement noter si elle crie aussi fort, plus fort, moins fort que d’habitude, et combien de temps, plus longtemps, moins longtemps... Et de votre côté, en prescrivant le symptôme, comme on le dit dans notre jargon, vous surferez sur la vague au lieu de vous la prendre sur la tête à chaque fois tout en serrant les dents et en crispant les orteils. »
Avec cette prescription, au lieu de ne rien dire et de laisser faire, la maman a quelque chose de précis à dire ; au lieu de penser : « si seulement ma fille pouvait ne pas crier et faire ce que je lui dis », elle lui conseille chaleureusement d’exprimer son mécontentement autant qu’elle le veut car cela ne la dérange pas (et elle doit être sincère en le disant). Nous voyons comment, dans ce cas, notre fameux 180 degrés par rapport aux tentatives de solution – c’est-à-dire notre intervention thérapeutique – consiste à prescrire le symptôme. La dynamique relationnelle d’escalade symétrique s’est transformée en une complémentarité. Claudine revient deux semaines plus tard, surprise et amusée. Charlotte n’a quasiment plus crié. Elle a dit qu’elle n’avait pas envie de faire certaines choses, mais ça a été.
Quand il a fallu aller à la bibliothèque rendre les livres de la semaine écoulée, elle a essayé de marcher très lentement alors que sa mère voulait avancer, mais Claudine, encouragée par les résultats de la première prescription de symptôme, s’est autorisée à lui proposer de marcher à son rythme tandis qu’elle et sa soeur avançaient au leur (l’environnement était sans danger). Ici aussi, nous avons une complémentarité. Charlotte s’est empressée de leur emboîter le pas. Une condition sine qua non : prescrire le symptôme se fait sans sarcasme ni ironie, mais avec conviction (pour cela, le thérapeute se sera assuré que la personne a bien saisi et intégré toutes les subtilités de l’intervention), avec fermeté (car elle va tenir ce qu’elle a décidé de tenir) et avec une sincère bienveillance.
HISTOIRE DE CYRIL ET DE SA MAMAN
Ce sont les deux parents d’un garçon de 9 ans qui viennent avec leur fils, Cyril. Lorsque l’orthophoniste de Cyril, qu’elle suit pour une dyslexie, leur a conseillés de venir me voir, celui-ci répétait régulièrement qu’il était nul, qu’il ne comprenait rien, qu’il en avait marre et qu’il serait mieux s’il était mort. Tout le monde était en alerte. Je lui demande :
- Th. : « Tu en as tellement marre que tu dis que tu serais mieux si tu étais mort, c’est ça ?
- Cyril : Oui.
- Th. : Je vois ça... (silence). Tu serais mieux et tu en aurais moins marre s’il se passait quoi de différent ?
- Cyril : Je n’aime pas l’école – enfin j’aime quand même bien les copains à l’école –, mais surtout je déteste les devoirs, je ne comprends rien et j’y arrive pas.
- Th. : Ah, c’est sûr que comme ça, c’est vraiment pénible... (silence). Mais toi, tu dis que tu voudrais ne jamais faire les devoirs ?
- Cyril : Ah non, ce n’est pas possible, ça ! J’aurais encore de plus mauvaises notes !
- Th. : Bon, donc tu es en train de me dire que si tu pouvais rendre les devoirs moins pénibles, étant donné que tu ne peux pas les éviter, ce serait franchement mieux, j’ai bien compris ?
- Cyril : Oui.
- Th. : D’accord, on va voir si on est capables de faire ça. » Nous tenons donc un objectif. Quelques mots sur le contexte : Cyril n’a pas franchement des résultats épouvantables à l’école, et il ne déteste pas son enseignante.
C’est un garçon fin et intelligent. C’est juste, dit-il, que c’est dur, qu’il doit beaucoup travailler, qu’il est souvent déçu des résultats qu’il obtient et qu’il préfère jouer. A part ça, il aime apprendre d’autres choses et regarder des documentaires sur la nature, les planètes et les animaux. La maman, qui reconnaît que l’école telle qu’elle existe n’est pas vraiment idéale pour son fils et réciproquement, est à la demande des enseignants très investie dans le travail scolaire, elle assume cette responsabilité (tandis que le papa s’occupe des sports). Sachant que son fils a des problèmes de dyslexie, elle fait de son mieux pour qu’il apprenne, révise, et elle a charge de lui demander des choses en plus (les exercices de l’orthophoniste, plus d’autres pour s’assurer qu’il a bien compris les leçons de l’école). Elle fait naturellement cela pour son bien, puisque dans un an et demi c’est la 6e et qu’il faut qu’il soit préparé. Résultat : le travail scolaire exige en effet beaucoup de temps (trop de temps), mais ce temps est quasiment doublé à cause des scènes et des drames entre le fiston et sa maman, préalables au travail en tant que tel. Là aussi, il s’agit d’une escalade symétrique.
Sa maman l’appelle : « Cyril, c’est l’heure de faire les devoirs... »...
Pour lire la suite...
HISTOIRE DE CLAUDINE ET CHARLOTTE
Claudine, maman de deux filles respectivement âgées de 9 ans et de 6 ans, appelle pour prendre rendez-vous pour sa deuxième fille, Charlotte. Motif : « Charlotte, raconte Claudine, a un sacré cabochon, et lorsqu’elle n’est pas contente, elle peut hurler pendant longtemps. » Elle s’oppose fréquemment aux décisions des membres de sa famille, ce qui lui donne autant d’occasions de crier. Je lui demande tout de suite si Charlotte se plaint elle-même de quelque chose. « Absolument pas, répond Claudine. C’est pour nous (les trois autres membres de la famille) que c’est difficile. » Décision est prise de voir les parents seuls, dans le but de les outiller et de les embaucher « comme co-thérapeutes » afin d’aider leur fille. C’est ce que nous appelons une « thérapie indirecte », que nous pratiquons avec les personnes qui souffrent d’un problème et qui sont mobilisables lorsque le patient désigné ne veut pas ou ne peut pas venir consulter. J’ai choisi de vous présenter le cas de Claudine car il a une originalité : les parents (surtout la maman) se veulent compréhensifs, à l’écoute, leur éducation doit être positive ; une confrontation un peu énergique avec sa fille lui est impensable car assimilée à de la brutalité. Elle cède dans la plupart des cas, lorsqu’elle considère qu’elle peut laisser sa fille faire comme elle veut, mais tient bon parfois lorsqu’elle décide qu’elle n’a vraiment pas le choix.
Concrètement, lorsque Charlotte est mécontente, par exemple de devoir marcher dans la rue pour aller à un endroit où elle ne veut pas aller – comme à la bibliothèque pour rendre les livres empruntés –, elle hurle tout ce qu’elle peut tandis que sa mère (ou parfois son père) la traîne pour qu’elle avance. La dernière fois, elle s’est égosillée pendant vingt minutes, puis s’est plainte d’avoir mal à la gorge. Les passants la regardent, font parfois des commentaires, mais elle est dans sa bulle et ne semble pas en être affectée. Dans la plupart des familles, généralement, les tentatives de solution des parents consistent à ordonner à l’enfant de se taire puis à exploser dans une escalade symétrique lorsqu’ils n’en peuvent plus, ou alors à céder par lassitude et souvent par honte devant le regard d’autrui. Mais pas Claudine. Elle a compris qu’être frontale avec sa cabocharde de fille ne sert à rien, elle ne veut pas lui faire du mal psychologiquement, alors elle se tait, la tire effectivement pour la faire avancer tandis que la petite crie à qui mieux mieux jusqu’à ce qu’elle soit distraite par autre chose et arrête de crier.
Claudine raconte tout cela de manière assez placide, mais lorsque j’approfondis un peu elle avoue qu’elle est « fortement agacée ». Fortement agacée, mais elle ne dit rien. Et maintenant, il faut rejoindre Claudine, soigner la relation avec elle, lui faire sentir qu’elle a été entendue et comprise quant au problème pour lequel elle consulte, tout en commençant à intervenir sur sa perception : car nous devons guider la personne de manière à ce qu’elle fasse un 180 degrés par rapport à ses tentatives de solutions, c’est-à-dire carrément le contraire de ce qu’elle faisait jusqu’à présent et qui ne fonctionnait pas. Nous devons la rejoindre, l’accompagner et la conduire (« pacing and leading », comme le disait Milton Erickson), et dans cette communication le savoir-faire hypnotique a toute sa place. Je demande à Claudine :
- Thérapeute : « Pensez-vous que Charlotte n’a pas capté votre agacement ?
- Claudine : Si, si, elle l’a capté, même si elle est complètement dans son truc quand elle crie pendant si longtemps. En même temps, je ne vais pas l’empêcher d’exprimer son ressenti... J’ai une image de la petite Charlotte toute seule « dans son truc », dans sa transe de contrariété, de colère et de douleur.
- Th. : Non, non, bien sûr que non. Mais récapitulons un peu : Charlotte est contrariée, très contrariée, elle l’exprime, pour l’exprimer elle peut crier dans ce grand vide sidéral où personne ne lui dit rien, où finalement elle est prise dans sa colère, toute seule avec elle-même tout en étant dans le monde parmi les autres, et par ailleurs même si vous ne lui dites rien, elle sent bien que vous êtes agacée, que cela ne vous convient pas, finalement. Pour le dire autrement, d’un côté elle peut crier, de l’autre elle sait que cela ne vous va pas... »
En effet, comme nous l’a appris Paul Watzlawick, « on ne peut pas ne pas communiquer »... Nous voyons qu’à ce stade, en terme de dynamique interactionnelle, nous n’avons pas de franche escalade symétrique, où les deux protagonistes se livreraient à un bras de fer doublé d’une réelle dispute, mais nous n’avons pas non plus une franche relation complémentaire, où l’un des deux céderait au bénéfice de l’autre. C’est une symétrie plus larvée, où la maman tient son objectif mais ne dit rien car elle ne veut pas tomber dans le piège de forcer sa fille à ne pas crier, et où la fille fait à sa manière les pieds au mur mais où elle n’a pas d’autre choix, semble-t-il, que de crier jusqu’à n’en plus pouvoir. La maman a fait un choix éducatif plus permissif, dirions-nous, mais elle se tait. Et elle communique malgré elle un agacement, un « j’aimerais que tu te comportes autrement », et on la comprend ! On pourrait dire que ce qu’elle a mis en place, c’est quelque chose à mi-chemin entre la tentative de solution classique de l’escalade symétrique qu’elle veut éviter, et un 180 degrés accompli. Elle est coincée dans le dilemme suivant : « comme il est hors de question que je crie moi-même alors que ma fille crie, je me tais (mais ça n’est pas satisfaisant) ».
Nous sommes dans une relation complémentaire problématique car en contradiction avec ce qu’elle pense : « Si seulement elle pouvait ne pas crier ! » Ce qui représente tout de même une escalade symétrique. Et comme elle ne peut pas toujours laisser sa fille faire ce qu’elle veut (par exemple, la laisser seule dans la rue), elle la tire tandis que la petite résiste en criant (mais ça n’est pas satisfaisant non plus). Là aussi, nous avons une escalade symétrique. Telle est la dynamique interactionnelle du problème, sur laquelle nous allons calquer la dynamique interactionnelle de la solution de manière à faire vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qui n’a pas fonctionné. Voici donc la prescription thérapeutique telle qu’elle a été donnée à Claudine :
- Th. : « Comme nous l’avons vu, Charlotte sent que vous espéreriez qu’elle se comporte autrement, mais comme elle est contrariée – et fâchée contre vous –, elle n’est pas près de vous faire ce plaisir. En même temps, il semble qu’elle puisse se retrouver comme coincée dans cette émotion de grande contrariété qui l’oblige à hurler dans la durée, jusqu’à en avoir mal à la gorge, mais c’est comme si elle n’avait pas d’autre choix pour le moment. Je voudrais vous proposer une alternative, une indication très bien traitante et bienveillante qui à mon avis coche toutes les cases de ce qui est important pour vous – et pour moi. Cette alternative, en essence, va communiquer à Charlotte : “tu as le droit d’avoir des émotions, tu as le droit de les manifester, je t’en prie fais-le, et cela me va tout à fait, je n’en suis pas incommodée.
Mais nous allons tout de même faire ce que j’ai prévu qu’on fasse”. Concrètement, voici ce que cela peut donner : “ma chérie, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire, et tu vas certainement avoir envie de crier, je t’en prie si ça te fait du bien n’hésite pas à crier autant que tu le peux pendant que nous marchons, car nous allons aller rendre les livres à la bibliothèque”. Alors vous comprenez que si Charlotte crie tant qu’elle peut, elle vous aura obéi, n’est-ce pas, et nous serons contentes qu’elle vous ait obéi ! Et si au contraire elle ne crie pas, mettons qu’elle vous regarde bizarrement ou se mette à bouder mais ne crie pas, elle vous aura désobéi mais nous serons contentes aussi, n’est-ce pas ? Tout le monde sera gagnant. Et bien sûr vous ne lui direz pas : “tu vois, quand tu veux, tu peux être sympa !”. Donc, qu’elle crie ou qu’elle ne crie pas, qu’elle vous obéisse ou qu’elle vous désobéisse, tout le monde sera gagnant et elle aura eu de vrais choix. Car vous savez, c’est très différent pour un enfant de crier de manière interminable, sans l’avoir vraiment choisi mais sans pouvoir faire autrement, et de crier parce que sa mère le lui a demandé.
Là, ce sera vraiment une décision. Dans ce dernier cas, si elle crie, alors vous devrez attentivement noter si elle crie aussi fort, plus fort, moins fort que d’habitude, et combien de temps, plus longtemps, moins longtemps... Et de votre côté, en prescrivant le symptôme, comme on le dit dans notre jargon, vous surferez sur la vague au lieu de vous la prendre sur la tête à chaque fois tout en serrant les dents et en crispant les orteils. »
Avec cette prescription, au lieu de ne rien dire et de laisser faire, la maman a quelque chose de précis à dire ; au lieu de penser : « si seulement ma fille pouvait ne pas crier et faire ce que je lui dis », elle lui conseille chaleureusement d’exprimer son mécontentement autant qu’elle le veut car cela ne la dérange pas (et elle doit être sincère en le disant). Nous voyons comment, dans ce cas, notre fameux 180 degrés par rapport aux tentatives de solution – c’est-à-dire notre intervention thérapeutique – consiste à prescrire le symptôme. La dynamique relationnelle d’escalade symétrique s’est transformée en une complémentarité. Claudine revient deux semaines plus tard, surprise et amusée. Charlotte n’a quasiment plus crié. Elle a dit qu’elle n’avait pas envie de faire certaines choses, mais ça a été.
Quand il a fallu aller à la bibliothèque rendre les livres de la semaine écoulée, elle a essayé de marcher très lentement alors que sa mère voulait avancer, mais Claudine, encouragée par les résultats de la première prescription de symptôme, s’est autorisée à lui proposer de marcher à son rythme tandis qu’elle et sa soeur avançaient au leur (l’environnement était sans danger). Ici aussi, nous avons une complémentarité. Charlotte s’est empressée de leur emboîter le pas. Une condition sine qua non : prescrire le symptôme se fait sans sarcasme ni ironie, mais avec conviction (pour cela, le thérapeute se sera assuré que la personne a bien saisi et intégré toutes les subtilités de l’intervention), avec fermeté (car elle va tenir ce qu’elle a décidé de tenir) et avec une sincère bienveillance.
HISTOIRE DE CYRIL ET DE SA MAMAN
Ce sont les deux parents d’un garçon de 9 ans qui viennent avec leur fils, Cyril. Lorsque l’orthophoniste de Cyril, qu’elle suit pour une dyslexie, leur a conseillés de venir me voir, celui-ci répétait régulièrement qu’il était nul, qu’il ne comprenait rien, qu’il en avait marre et qu’il serait mieux s’il était mort. Tout le monde était en alerte. Je lui demande :
- Th. : « Tu en as tellement marre que tu dis que tu serais mieux si tu étais mort, c’est ça ?
- Cyril : Oui.
- Th. : Je vois ça... (silence). Tu serais mieux et tu en aurais moins marre s’il se passait quoi de différent ?
- Cyril : Je n’aime pas l’école – enfin j’aime quand même bien les copains à l’école –, mais surtout je déteste les devoirs, je ne comprends rien et j’y arrive pas.
- Th. : Ah, c’est sûr que comme ça, c’est vraiment pénible... (silence). Mais toi, tu dis que tu voudrais ne jamais faire les devoirs ?
- Cyril : Ah non, ce n’est pas possible, ça ! J’aurais encore de plus mauvaises notes !
- Th. : Bon, donc tu es en train de me dire que si tu pouvais rendre les devoirs moins pénibles, étant donné que tu ne peux pas les éviter, ce serait franchement mieux, j’ai bien compris ?
- Cyril : Oui.
- Th. : D’accord, on va voir si on est capables de faire ça. » Nous tenons donc un objectif. Quelques mots sur le contexte : Cyril n’a pas franchement des résultats épouvantables à l’école, et il ne déteste pas son enseignante.
C’est un garçon fin et intelligent. C’est juste, dit-il, que c’est dur, qu’il doit beaucoup travailler, qu’il est souvent déçu des résultats qu’il obtient et qu’il préfère jouer. A part ça, il aime apprendre d’autres choses et regarder des documentaires sur la nature, les planètes et les animaux. La maman, qui reconnaît que l’école telle qu’elle existe n’est pas vraiment idéale pour son fils et réciproquement, est à la demande des enseignants très investie dans le travail scolaire, elle assume cette responsabilité (tandis que le papa s’occupe des sports). Sachant que son fils a des problèmes de dyslexie, elle fait de son mieux pour qu’il apprenne, révise, et elle a charge de lui demander des choses en plus (les exercices de l’orthophoniste, plus d’autres pour s’assurer qu’il a bien compris les leçons de l’école). Elle fait naturellement cela pour son bien, puisque dans un an et demi c’est la 6e et qu’il faut qu’il soit préparé. Résultat : le travail scolaire exige en effet beaucoup de temps (trop de temps), mais ce temps est quasiment doublé à cause des scènes et des drames entre le fiston et sa maman, préalables au travail en tant que tel. Là aussi, il s’agit d’une escalade symétrique.
Sa maman l’appelle : « Cyril, c’est l’heure de faire les devoirs... »...
Pour lire la suite...
NATHALIE KORALNIK
Enseigne l’approche systémique et stratégique brève et l’hypnose ericksonienne à l’Institut Gregory Bateson (IGB). Elle consulte en cabinet privé dans la région lyonnaise en français, anglais et italien, et supervise des équipes socio-éducatives dans sa région. Egalement traductrice et interprète, elle traduit des séminaires et des ouvrages dans ses domaines de compétence.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°74 version Papier
La puissance thérapeutique de la relation humaine
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°74 :
Si la prise en compte du corps relationnel est au centre des changements en thérapie, cela implique pour le thérapeute d’être attentif au contexte relationnel favorisant les processus dissociatifs. Et pour favoriser les processus de réassociation, le thérapeute doit être en capacité de modifier les interactions qui entretiennent le problème.
. Nathalie Koralnik, dans un texte clair et pédagogique, nous montre comment la prescription du symptôme permet à des parents consultant pour des problèmes récurrents, avec une escalade symétrique de disputes et de crises, de retrouver une relation éducative positive, les parents pouvant s’investir dans un rôle de co-thérapeutes. L’approche stratégique, lorsqu’elle est pensée de manière coopérative, est vraiment un outil de choix pour sortir des impasses relationnelles.
. Delphine Le Gris nous parle de Mélanie, une jeune femme en grande souffrance après une rupture sentimentale où la relation de couple était depuis longtemps perçue comme maltraitante. En s’immergeant dans l’histoire de sa patiente, l’image de la mer et de l’eau est apparue, avec des vagues réparatrices permettant de retrouver les ressources enfuies et de rendre possible l’oubli des relations difficiles emportées au large. Nous voyons ainsi l’importance pour le thérapeute de se connecter à l’histoire racontée par le sujet pour ouvrir un imaginaire partagé, dans lequel la vie relationnelle va reprendre sa place.
. Michel Dumas évoque l’histoire de Stéphanie, confrontée à la déliquescence de la relation avec son mari qui, le plus souvent, met en scène sa tristesse et se réfugie devant son téléviseur. Elle ne parvient pas à aborder avec son conjoint cette situation où elle se sent de moins en moins aimée, car elle a peur d’un conflit qui provoquerait les conséquences qu’elle redoute. Après un recadrage : « si tu fais l’agneau, tu trouveras le loup qui te mangera », le thérapeute prescrit trois tâches stratégiques possibles pour sortir de ce cercle vicieux relationnel.
. Jérémie Roos nous raconte comment la situation bloquée de Zohra, attaquée par un chien, a pu évoluer grâce au sous-main de son bureau utilisé comme une scène imaginaire. Celle-ci permettra l’émergence de nouvelles formes relationnelles, ouvrant de nouveaux possibles grâce au soutien de la relation thérapeutique.
. Gérard Ostermann nous présente la synthèse effectuée par Michel Ruel, à partir du travail de la CFHTB, sur l’utilisation de l’hypnose pour faire face à la souffrance au travail. Il rappelle l’importance de différencier le pré-effondrement de l’effondrement dans ces prises en charge. L’illustration clinique de la situation inquiétante d’un cadre d’entreprise subissant un début de désocialisation met en évidence l’intérêt du travail avec les métaphores pour retrouver des objectifs atteignables.
. Morgane Monnier, quant à elle, nous présente l’intérêt de l’hypnose et des thérapies brèves pour améliorer les prises en charge en psychomotricité.Dans le dossier thématique « Thérapie et relation »,
. Géraldine Garon et Solen Montanari mettent en lumière la puissance thérapeutique de la relation humaine lorsque le thérapeute et le patient entrent dans un processus de co-construction par un travail de questionnement permettant l’émergence d’un imaginaire partagé. Elles montrent, à travers les situations de Lou (qui se plaint de tics) et de Mathilde (présentant un excès de poids), comment l’externalisation nourrit le processus thérapeutique en favorisant l’accordage. Cet article décrit très bien l’apport de la TLMR à la mobilisation des ressources et au repositionnement du sujet.
A partir de trois situations cliniques, Charlotte Thouvenot décrit avec précision l’importance de la carte du remembering pour retrouver une relation vivante et faire l’expérience de l’estime de soi.
. Olivier de Palézieux développe une meilleure compréhension du concept d’empathie, au centre de la relation. Pour cela, il en décrit l’historique et les variations de sens. Il illustre l’intérêt de sa réflexion à propos du cas de Lucas présentant un TSA (trouble du spectre autistique).
Vous retrouverez la chronique de Sophie Cohen sur une première consultation autour de la détresse conjugale et des réseaux sociaux, celle de Sylvie Le Pelletier-Beaufond « Passer les portes secrètes et apaiser les craintes ». Tandis que Stefano Colombo et Muhuc vous feront découvrir ce qui peut se cacher derrière la « peur du conflit »..
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°74 :
Si la prise en compte du corps relationnel est au centre des changements en thérapie, cela implique pour le thérapeute d’être attentif au contexte relationnel favorisant les processus dissociatifs. Et pour favoriser les processus de réassociation, le thérapeute doit être en capacité de modifier les interactions qui entretiennent le problème.
. Nathalie Koralnik, dans un texte clair et pédagogique, nous montre comment la prescription du symptôme permet à des parents consultant pour des problèmes récurrents, avec une escalade symétrique de disputes et de crises, de retrouver une relation éducative positive, les parents pouvant s’investir dans un rôle de co-thérapeutes. L’approche stratégique, lorsqu’elle est pensée de manière coopérative, est vraiment un outil de choix pour sortir des impasses relationnelles.
. Delphine Le Gris nous parle de Mélanie, une jeune femme en grande souffrance après une rupture sentimentale où la relation de couple était depuis longtemps perçue comme maltraitante. En s’immergeant dans l’histoire de sa patiente, l’image de la mer et de l’eau est apparue, avec des vagues réparatrices permettant de retrouver les ressources enfuies et de rendre possible l’oubli des relations difficiles emportées au large. Nous voyons ainsi l’importance pour le thérapeute de se connecter à l’histoire racontée par le sujet pour ouvrir un imaginaire partagé, dans lequel la vie relationnelle va reprendre sa place.
. Michel Dumas évoque l’histoire de Stéphanie, confrontée à la déliquescence de la relation avec son mari qui, le plus souvent, met en scène sa tristesse et se réfugie devant son téléviseur. Elle ne parvient pas à aborder avec son conjoint cette situation où elle se sent de moins en moins aimée, car elle a peur d’un conflit qui provoquerait les conséquences qu’elle redoute. Après un recadrage : « si tu fais l’agneau, tu trouveras le loup qui te mangera », le thérapeute prescrit trois tâches stratégiques possibles pour sortir de ce cercle vicieux relationnel.
. Jérémie Roos nous raconte comment la situation bloquée de Zohra, attaquée par un chien, a pu évoluer grâce au sous-main de son bureau utilisé comme une scène imaginaire. Celle-ci permettra l’émergence de nouvelles formes relationnelles, ouvrant de nouveaux possibles grâce au soutien de la relation thérapeutique.
. Gérard Ostermann nous présente la synthèse effectuée par Michel Ruel, à partir du travail de la CFHTB, sur l’utilisation de l’hypnose pour faire face à la souffrance au travail. Il rappelle l’importance de différencier le pré-effondrement de l’effondrement dans ces prises en charge. L’illustration clinique de la situation inquiétante d’un cadre d’entreprise subissant un début de désocialisation met en évidence l’intérêt du travail avec les métaphores pour retrouver des objectifs atteignables.
. Morgane Monnier, quant à elle, nous présente l’intérêt de l’hypnose et des thérapies brèves pour améliorer les prises en charge en psychomotricité.Dans le dossier thématique « Thérapie et relation »,
. Géraldine Garon et Solen Montanari mettent en lumière la puissance thérapeutique de la relation humaine lorsque le thérapeute et le patient entrent dans un processus de co-construction par un travail de questionnement permettant l’émergence d’un imaginaire partagé. Elles montrent, à travers les situations de Lou (qui se plaint de tics) et de Mathilde (présentant un excès de poids), comment l’externalisation nourrit le processus thérapeutique en favorisant l’accordage. Cet article décrit très bien l’apport de la TLMR à la mobilisation des ressources et au repositionnement du sujet.
A partir de trois situations cliniques, Charlotte Thouvenot décrit avec précision l’importance de la carte du remembering pour retrouver une relation vivante et faire l’expérience de l’estime de soi.
. Olivier de Palézieux développe une meilleure compréhension du concept d’empathie, au centre de la relation. Pour cela, il en décrit l’historique et les variations de sens. Il illustre l’intérêt de sa réflexion à propos du cas de Lucas présentant un TSA (trouble du spectre autistique).
Vous retrouverez la chronique de Sophie Cohen sur une première consultation autour de la détresse conjugale et des réseaux sociaux, celle de Sylvie Le Pelletier-Beaufond « Passer les portes secrètes et apaiser les craintes ». Tandis que Stefano Colombo et Muhuc vous feront découvrir ce qui peut se cacher derrière la « peur du conflit »..