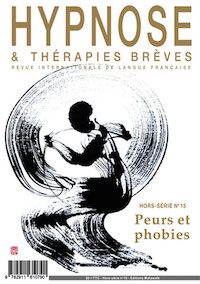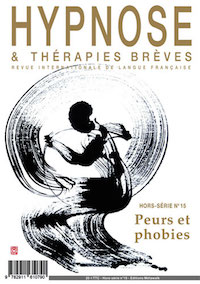© Maya Vincent
Résumé
En consultation, nombre de patients consultent sous la contrainte, qu’elle soit explicite (conjoint, médecin traitant, police, justice) ou implicite (pour leurs enfants, leur famille, les autres... ou même pour leur santé). Ainsi, au-delà du fait que le soignant est confronté au paradoxe de soigner des sujets qui ne le demandent pas, il se trouve dans une double contrainte, considéré par les uns comme garant de l’ordre social, et par les autres comme aidant d’un sujet en souffrance. Or, on ne change que pour deux raisons, soit on y est contraint, soit on en est convaincu... alors que changer demeure complexe et incertain et donc source de peur. Le modèle transthéorique du changement nous a montré que le changement n’était ni fixé, ni constant, qu’il était souvent teinté d’ambivalence, de résistance et même de rechute, pourtant ce modèle considère encore la contrainte comme un frein plutôt qu’un levier de changement. Nous souhaitons exposer ici que la contrainte peut devenir un levier de changement... encore faut-il avoir les outils adéquats pour permettre à chacun (contraint ou non) de comprendre que l’implication dans les soins lui permettra de retrouver son libre-arbitre.
Introduction
En pratique clinique, nous sommes régulièrement confrontés aux soins non consentis, aux soins sous contrainte, à l’absence (explicite) de demande de soins. Des situations qui placent les thérapeutes (psychiatres, psychologues, infirmiers psychiatriques) face à un paradoxe de taille : aider des patients qui ne le demandent pas. Ces situations mettent les soignants en difficulté, alors qu’il existe depuis longtemps des lois qui énoncent la possibilité de réaliser des soins sans le consentement du sujet (en particulier en psychiatrie), considérant que lorsqu’un sujet n’est plus en mesure de donner son consentement aux soins en raison d’un trouble psychiatrique, ce serait plus l’absence de soins qui créerait préjudice au patient que leur mise en oeuvre sans son consentement. Quant aux addictions, cela fait bien longtemps que des juges peuvent obliger nos compatriotes à des soins (par exemple en raison des conséquences de leurs addictions). En effet, dans les années 1970, face à la montée de la « toxicomanie », les autorités mirent en place l’injonction thérapeutique (une mesure qui peut être mise en place avant ou après le jugement). Qu’il s’agisse de l’obligation de soins ou de l’injonction de soin, le condamné au suivi sociojudiciaire doit se soumettre au contrôle des juges (Baron-Laforet, 2009). Mais il est d’autres situations où la contrainte est au coeur des soins sans pour autant dire son nom : l’adolescent amené par ses parents, le sujet souffrant d’addiction envoyé par son médecin traitant, sa compagne ou son compagnon (sous la menace d’une rupture). Il existe même des situations de contrainte cachée, comme celle de consulter sous la contrainte de sa propre santé (arrêter le tabac par peur du cancer, arrêter l’alcool par peur du diabète, de l’hypertension) ou encore arrêter l’alcool pour ses enfants (par peur de ne pas être un bon parent). Et dans ces circonstances, si ce n’est pas (directement) la loi qui conduit le patient face au thérapeute... comment construire une thérapie face à cette absence totale de motivation intrinsèque ?
Le caractère obligatoire de l’intervention ne fait-il pas obstacle à sa mise en oeuvre ?
Que le sujet soit incapable de donner son consentement aux soins, ou qu’il y soit contraint par un tiers ou par lui-même, il place le thérapeute entre l’aide et le contrôle : soit ce dernier n’est vu que comme le repré - sentant du corps social, soit il est vu comme un allié du patient contre le corps social qui le contraint. Or, ces deux positions ne sont pas tenables et constituent une « double contrainte » pour le thérapeute qui dans un cas comme dans l’autre n’a plus la posture ad hoc pour permettre au sujet de devenir acteur de sa thérapie, client de son changement. Le choix que nous faisons ici est un choix systémique (interactionnel) : il n’est pas meilleur qu’un autre, tout au plus est-il plus pragmatique et centré sur les solutions, plutôt que sur l’analyse des problèmes.
Des soins sous contrainte ?
Alors qu’il nous a été longtemps enseigné que l’efficacité des thérapies dépendait de l’engagement du patient, que le changement ne pouvait venir que de lui, qu’il était inenvisageable de forcer quelqu’un à changer et que le libre-arbitre est un des fondamentaux de la relation d’aide, la notion de soins contraints peut paraître aberrante. Pourtant les soins obligés par la justice existent aux USA depuis la fin des années 1980 (drug courts) pour le jugement d’infractions en lien avec l’usage de drogues (Nolan, 2002). Le juge, plutôt que de sanctionner, accompagne un processus thérapeutique qu’il coordonne et dont il vérifie l’application, lui conférant un statut de case manager. Les principales caractéristiques de ces dispo - sitifs sont leur dimension collaborative, empathique et fondée sur les changements observés, l’intégration de la prise en charge thérapeutique dans le processus judiciaire, la supervision judiciaire et un système de sanctions/récompenses gradué (Mitchell, 2012). L’efficacité globale est significativement positive avec un taux global de récidive de 38 % avec ce système, contre 50 % dans le dispositif judiciaire classique, qu’il s’agisse d’infractions à la législation pour les stupéfiants ou d’infractions rou - tières en lien avec des conduites d’alcoolisation. Ainsi, il serait possible qu’être obligé à se soigner soit efficace... et que la mise en place de la loi devienne une aide.
Car la conduite addictive est contradictoire : le sujet y perd sa liberté au nom de la liberté, y trouve l’aliénation au nom du droit à la folie et se retrouve dépendant au nom de l’indépendance ! (Danel et al., 2009). En effet, un sujet présentant une conduite addictive perd son libre-arbitre non seulement en raison des effets psychoactifs de la substance, mais aussi en raison du caractère liberticide de l’addiction en soi dont la définition (impossibilité répétée de contrôler un comportement entraînant sa poursuite en dépit de ses conséquences négatives) parle d’elle-même. Ainsi en addictologie les patients consultent rarement pour se libérer de l’emprise d’une substance ou d’un comportement dont ils se considèrent les esclaves. Le plus souvent, ils rencontrent les soins poussés par des tiers ou par eux-mêmes. Et ce caractère obligé de ces demandes nécessite un certain recadrage, une nouvelle lecture de la demande, définissant la position du patient au regard du soin en question et le moyen d’en faire un levier de changement.
Motivation
La prise d’un toxique peut être festive et avec le temps devenir une addiction : le sujet utilise une substance pour égayer son quotidien et finit par ne plus pouvoir s’en passer pour vivre (puis pour survivre). Avec la répétition de son usage, le sujet ne se rend pas compte qu’elle entretient le problème (il consomme pour diminuer sa souffrance, alors que la substance psychoactive induit des troubles psychiques). Et c’est ainsi qu’il entretient le déni que cette substance est nocive pour sa santé, qu’elle a des conséquences majeures sur son environnement et que lorsqu’il est au stade de la dépendance, elle le prive de liberté. Pourtant, que l’addiction soit un comportement appris par entraînement ou le symptôme d’une souffrance devenue auto-entretenue, on comprend qu’il n’est pas aisé de trouver les motivations pour demander des soins. Et attendre que le patient soit demandeur n’est pas un critère suffisant pour réussir un changement. Car à interroger les patients, certains en arrivent à prétendre qu’ils n’ont pas envie d’arrêter. Alors qu’en réalité, ce n’est pas l’envie qui leur manque. Après avoir vainement essayé d’arrêter, ils ont fini par se convaincre que cela leur sera impossible. Mais s’ils pouvaient arrêter sans souffrir, ils s’arrêteraient tout de suite. Ils seraient même d’accord pour faire des efforts s’ils pouvaient être sûrs du résultat (Isebaert, 2009). La tâche d’un thérapeute pourrait être donc d’augmenter leur confiance et leur motivation dans leur capacité à changer et de pouvoir vivre comme ils le souhaitent.
La motivation désigne les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance d’un comportement (Vallerand, 1993). Le modèle du changement proposé par James Prochaska et Carlo Di Clemente (Di Clemente & Prochaska, 1998) postule plusieurs stades de motivation au changement. Ce modèle nous a d’ailleurs permis de comprendre que le changement n’est pas un événement brutal, mais un parcours qui s’accomplit par une succession de stades et par une série de cycles. Il a ainsi permis le développement de l’approche motivationnelle (Miller & Rollnick, 1991) qui prône un style communicationnel indirect inspiré clairement des modèles ericksoniens, intégrant l’ambivalence au changement, la balance décisionnelle et la fonction du symptôme dans la protection de soi. Ce modèle s’oppose ainsi aux styles d’interventions traditionnels privilégiant la suggestion directe comme seul outil théra - peutique. Car la persuasion directe n’est pas le meilleur moyen de convaincre un sujet de changer, et si l’on pouvait résumer en deux mots l’approche motivationnelle, ils seraient : acceptation et empathie (Miller & Rollnick, 1991). Acceptation, car c’est en acceptant le sujet tel qu’il est qu’on lui donne la liberté de changer ; empathie, car elle consiste d’abord à comprendre le point de vue du sujet, en partir et suivre son rythme.
Ce modèle dynamique du changement décrit classiquement cinq étapes : - Au stade de pré-contemplation ou indétermination (absence de conscience du problème), le sujet addict est un consommateur qui estime ne pas avoir de problème. A ce stade, il est recommandé d’abord d’accepter que le sujet ne changera pas. Et si l’on devait intervenir, on ne chercherait guère qu’à faire naître le doute sur l’intérêt de maintenir ce comportement. A ce stade, on comprend bien qu’insister sur le fait que la consommation est un problème est une erreur, le sujet est dans le déni ou à tout le moins dans la dénégation (voire l’opposition caractérielle). - Au stade de contemplation ou intention (considération du changement), le sujet est ambivalent. Sa motivation à changer est fragile, autant dans le sens de maintenir le comportement que de le modifier. Le thérapeute ne peut avoir pour objectif que de travailler la balance décisionnelle (avantages et inconvénients à changer ou à maintenir le comportement).
- Au stade de préparation (prise de décision de changer), le sujet est prêt à changer. L’objectif du thérapeute est de baliser au mieux le plus court chemin vers le soin en proposant la solution la plus adaptée à sa demande.
- Au stade de l’action planifiée, inutile de chercher la motivation... elle est là. L’objectif est d’aider le sujet à maintenir son comportement modifié, de l’aider à identifier et utiliser les stratégies de prévention de la rechute.
- Au stade de consolidation (maintien de l’action planifiée menant à une guérison durable), le sujet est dans le maintien de nouveaux comportements et l’objectif est de renforcer les stratégies acquises et de prévenir la rechute.
- Enfin, intégrer la rechute comme stade de changement fut très judicieux de la part des concepteurs. C’est rappeler au patient (et au soignant) que le chemin peut être semé d’embûches, embûches liées au fait que l’addiction est une maladie chronique et récidivante. Ce n’est ni un problème moral, ni un fléau social, c’est une maladie du cerveau (Volkow, 2004) à la fois psychiatrique, neurobiologique et environnementale. Lors d’une rechute, c’est le moment de l’intégrer dans le processus de changement, de reprendre un travail de balance décisionnelle et d’éviter la paralysie de l’action liée à la culpabilité. La prescrire dans certaines situations peut même être paradoxalement salutaire. Toutefois, l’approche motivationnelle n’aborde pas l’existence d’une contrainte explicite ou implicite aux soins addictologiques. Un élément longtemps considéré comme un facteur limitant, dont nous avons fait au contraire un efficace levier de changement (Doutrelugne et Cottencin, 2011) dans le cadre des patients hospitalisés dans leur consentement.
La contrainte peut-elle être une motivation suffisante pour engager des soins ?
Selon les théories motivationnelles, les pressions externes diminuent la motivation interne, ce que l’on retrouve généralement dans les études (Simoneau, 2003). Toutefois nous savons aujourd’hui que c’est l’impact de la relation avec le thérapeute qui constitue l’élément clef de la motivation, qu’il y ait pression externe ou non. La motivation initiale, à tort définie comme une caractéristique stable du client, ne prédit pas la persévérance dans le traitement (Miller, 1985). Mais conceptualiser la motivation comme le produit d’échanges interpersonnels (Miller & Sanchez, 1994) entre le patient et le thérapeute est une évolution en parfait accord avec l’observation clinique. Ainsi pour le patient la vraie question est de savoir comment faire sienne la décision des autres. Car la situation la plus classique est une demande d’aide formulée sur pression de l’entourage par un patient en situation de crise, se considérant désigné par d’autres et pour un problème qu’il ne s’attribue pas mais qu’il attribue aux autres. Et s’il se plaint c’est plus souvent en raison des entraves que lui mettent les autres en lui imposant de se soigner alors qu’il ne se considère pas malade. C’est ainsi que nous avons longtemps considéré que les patients contraints n’étaient pas motivés. Alors qu’en réalité, ces patients sont motivés, mais pas sur les problèmes définis par les envoyeurs. En premier lieu, ils sont d’abord motivés à échapper à la contrainte. Et c’est la raison pour laquelle un soignant qui veut convaincre un patient contraint d’arrêter une addiction se range de facto à ses yeux du côté de la coercition. Il perd donc toute légitimité à communiquer puisqu’il n’est que le représentant de la contrainte. Si l’on veut pouvoir communiquer avec un patient contraint, il est inutile de chercher à le convaincre que l’envoyeur a raison de le contraindre. La contrainte est un fait... et il faut faire avec. Donc la question ici posée au soignant est de trouver le meilleur moyen de communiquer avec un sujet contraint, d’engager la rencontre en respectant ses mécanismes de défense et de mettre en valeur ses capacités d’autodétermination. La meilleure méthode pour ce faire est de centrer son discours sur les faits et d’agir au nom du principe de réalité (Doutrelugne et Cottencin, 2011). Il est plus efficace de valider la contrainte sans autre forme d’analyse plutôt que de renchérir les étiquettes de l’envoyeur (alcoolique, toxicomane, psychopathe...) ou de tenter de faire alliance avec le patient (au détriment de la réalité factuelle du comportement qui a imposé l’obligation aux soins). Ainsi en pratique, lors d’un premier entretien addictologique un soignant doit répondre à deux questions. Demande-t-il de l’aide ? Estil contraint ? Car en se focalisant sur la contrainte comme motif de con - sultation, il sera plus facile de définir des objectifs thérapeutiques qui lui seront acceptables.
Comment créer des résistances ?
« Ce fut un grand pas en avant de découvrir qu’un individu pouvait résister au changement à cause de so n contexte familial. Une étape plus importante encore fut de découvrir que la résistance de la famille pouvait être due à la technique du thérapeute » (Jay Haley, 1976). Le patient contraint de suivre une thérapie qu’il n’aura pas délibérément choisie sera contraint de résister au changement en mettant en échec tout l’étalage d’aide que l’on pourrait lui offrir.
Pour lire la suite de l’article et commander ce Hors-Série n°15 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves
En consultation, nombre de patients consultent sous la contrainte, qu’elle soit explicite (conjoint, médecin traitant, police, justice) ou implicite (pour leurs enfants, leur famille, les autres... ou même pour leur santé). Ainsi, au-delà du fait que le soignant est confronté au paradoxe de soigner des sujets qui ne le demandent pas, il se trouve dans une double contrainte, considéré par les uns comme garant de l’ordre social, et par les autres comme aidant d’un sujet en souffrance. Or, on ne change que pour deux raisons, soit on y est contraint, soit on en est convaincu... alors que changer demeure complexe et incertain et donc source de peur. Le modèle transthéorique du changement nous a montré que le changement n’était ni fixé, ni constant, qu’il était souvent teinté d’ambivalence, de résistance et même de rechute, pourtant ce modèle considère encore la contrainte comme un frein plutôt qu’un levier de changement. Nous souhaitons exposer ici que la contrainte peut devenir un levier de changement... encore faut-il avoir les outils adéquats pour permettre à chacun (contraint ou non) de comprendre que l’implication dans les soins lui permettra de retrouver son libre-arbitre.
Introduction
En pratique clinique, nous sommes régulièrement confrontés aux soins non consentis, aux soins sous contrainte, à l’absence (explicite) de demande de soins. Des situations qui placent les thérapeutes (psychiatres, psychologues, infirmiers psychiatriques) face à un paradoxe de taille : aider des patients qui ne le demandent pas. Ces situations mettent les soignants en difficulté, alors qu’il existe depuis longtemps des lois qui énoncent la possibilité de réaliser des soins sans le consentement du sujet (en particulier en psychiatrie), considérant que lorsqu’un sujet n’est plus en mesure de donner son consentement aux soins en raison d’un trouble psychiatrique, ce serait plus l’absence de soins qui créerait préjudice au patient que leur mise en oeuvre sans son consentement. Quant aux addictions, cela fait bien longtemps que des juges peuvent obliger nos compatriotes à des soins (par exemple en raison des conséquences de leurs addictions). En effet, dans les années 1970, face à la montée de la « toxicomanie », les autorités mirent en place l’injonction thérapeutique (une mesure qui peut être mise en place avant ou après le jugement). Qu’il s’agisse de l’obligation de soins ou de l’injonction de soin, le condamné au suivi sociojudiciaire doit se soumettre au contrôle des juges (Baron-Laforet, 2009). Mais il est d’autres situations où la contrainte est au coeur des soins sans pour autant dire son nom : l’adolescent amené par ses parents, le sujet souffrant d’addiction envoyé par son médecin traitant, sa compagne ou son compagnon (sous la menace d’une rupture). Il existe même des situations de contrainte cachée, comme celle de consulter sous la contrainte de sa propre santé (arrêter le tabac par peur du cancer, arrêter l’alcool par peur du diabète, de l’hypertension) ou encore arrêter l’alcool pour ses enfants (par peur de ne pas être un bon parent). Et dans ces circonstances, si ce n’est pas (directement) la loi qui conduit le patient face au thérapeute... comment construire une thérapie face à cette absence totale de motivation intrinsèque ?
Le caractère obligatoire de l’intervention ne fait-il pas obstacle à sa mise en oeuvre ?
Que le sujet soit incapable de donner son consentement aux soins, ou qu’il y soit contraint par un tiers ou par lui-même, il place le thérapeute entre l’aide et le contrôle : soit ce dernier n’est vu que comme le repré - sentant du corps social, soit il est vu comme un allié du patient contre le corps social qui le contraint. Or, ces deux positions ne sont pas tenables et constituent une « double contrainte » pour le thérapeute qui dans un cas comme dans l’autre n’a plus la posture ad hoc pour permettre au sujet de devenir acteur de sa thérapie, client de son changement. Le choix que nous faisons ici est un choix systémique (interactionnel) : il n’est pas meilleur qu’un autre, tout au plus est-il plus pragmatique et centré sur les solutions, plutôt que sur l’analyse des problèmes.
Des soins sous contrainte ?
Alors qu’il nous a été longtemps enseigné que l’efficacité des thérapies dépendait de l’engagement du patient, que le changement ne pouvait venir que de lui, qu’il était inenvisageable de forcer quelqu’un à changer et que le libre-arbitre est un des fondamentaux de la relation d’aide, la notion de soins contraints peut paraître aberrante. Pourtant les soins obligés par la justice existent aux USA depuis la fin des années 1980 (drug courts) pour le jugement d’infractions en lien avec l’usage de drogues (Nolan, 2002). Le juge, plutôt que de sanctionner, accompagne un processus thérapeutique qu’il coordonne et dont il vérifie l’application, lui conférant un statut de case manager. Les principales caractéristiques de ces dispo - sitifs sont leur dimension collaborative, empathique et fondée sur les changements observés, l’intégration de la prise en charge thérapeutique dans le processus judiciaire, la supervision judiciaire et un système de sanctions/récompenses gradué (Mitchell, 2012). L’efficacité globale est significativement positive avec un taux global de récidive de 38 % avec ce système, contre 50 % dans le dispositif judiciaire classique, qu’il s’agisse d’infractions à la législation pour les stupéfiants ou d’infractions rou - tières en lien avec des conduites d’alcoolisation. Ainsi, il serait possible qu’être obligé à se soigner soit efficace... et que la mise en place de la loi devienne une aide.
Car la conduite addictive est contradictoire : le sujet y perd sa liberté au nom de la liberté, y trouve l’aliénation au nom du droit à la folie et se retrouve dépendant au nom de l’indépendance ! (Danel et al., 2009). En effet, un sujet présentant une conduite addictive perd son libre-arbitre non seulement en raison des effets psychoactifs de la substance, mais aussi en raison du caractère liberticide de l’addiction en soi dont la définition (impossibilité répétée de contrôler un comportement entraînant sa poursuite en dépit de ses conséquences négatives) parle d’elle-même. Ainsi en addictologie les patients consultent rarement pour se libérer de l’emprise d’une substance ou d’un comportement dont ils se considèrent les esclaves. Le plus souvent, ils rencontrent les soins poussés par des tiers ou par eux-mêmes. Et ce caractère obligé de ces demandes nécessite un certain recadrage, une nouvelle lecture de la demande, définissant la position du patient au regard du soin en question et le moyen d’en faire un levier de changement.
Motivation
La prise d’un toxique peut être festive et avec le temps devenir une addiction : le sujet utilise une substance pour égayer son quotidien et finit par ne plus pouvoir s’en passer pour vivre (puis pour survivre). Avec la répétition de son usage, le sujet ne se rend pas compte qu’elle entretient le problème (il consomme pour diminuer sa souffrance, alors que la substance psychoactive induit des troubles psychiques). Et c’est ainsi qu’il entretient le déni que cette substance est nocive pour sa santé, qu’elle a des conséquences majeures sur son environnement et que lorsqu’il est au stade de la dépendance, elle le prive de liberté. Pourtant, que l’addiction soit un comportement appris par entraînement ou le symptôme d’une souffrance devenue auto-entretenue, on comprend qu’il n’est pas aisé de trouver les motivations pour demander des soins. Et attendre que le patient soit demandeur n’est pas un critère suffisant pour réussir un changement. Car à interroger les patients, certains en arrivent à prétendre qu’ils n’ont pas envie d’arrêter. Alors qu’en réalité, ce n’est pas l’envie qui leur manque. Après avoir vainement essayé d’arrêter, ils ont fini par se convaincre que cela leur sera impossible. Mais s’ils pouvaient arrêter sans souffrir, ils s’arrêteraient tout de suite. Ils seraient même d’accord pour faire des efforts s’ils pouvaient être sûrs du résultat (Isebaert, 2009). La tâche d’un thérapeute pourrait être donc d’augmenter leur confiance et leur motivation dans leur capacité à changer et de pouvoir vivre comme ils le souhaitent.
La motivation désigne les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance d’un comportement (Vallerand, 1993). Le modèle du changement proposé par James Prochaska et Carlo Di Clemente (Di Clemente & Prochaska, 1998) postule plusieurs stades de motivation au changement. Ce modèle nous a d’ailleurs permis de comprendre que le changement n’est pas un événement brutal, mais un parcours qui s’accomplit par une succession de stades et par une série de cycles. Il a ainsi permis le développement de l’approche motivationnelle (Miller & Rollnick, 1991) qui prône un style communicationnel indirect inspiré clairement des modèles ericksoniens, intégrant l’ambivalence au changement, la balance décisionnelle et la fonction du symptôme dans la protection de soi. Ce modèle s’oppose ainsi aux styles d’interventions traditionnels privilégiant la suggestion directe comme seul outil théra - peutique. Car la persuasion directe n’est pas le meilleur moyen de convaincre un sujet de changer, et si l’on pouvait résumer en deux mots l’approche motivationnelle, ils seraient : acceptation et empathie (Miller & Rollnick, 1991). Acceptation, car c’est en acceptant le sujet tel qu’il est qu’on lui donne la liberté de changer ; empathie, car elle consiste d’abord à comprendre le point de vue du sujet, en partir et suivre son rythme.
Ce modèle dynamique du changement décrit classiquement cinq étapes : - Au stade de pré-contemplation ou indétermination (absence de conscience du problème), le sujet addict est un consommateur qui estime ne pas avoir de problème. A ce stade, il est recommandé d’abord d’accepter que le sujet ne changera pas. Et si l’on devait intervenir, on ne chercherait guère qu’à faire naître le doute sur l’intérêt de maintenir ce comportement. A ce stade, on comprend bien qu’insister sur le fait que la consommation est un problème est une erreur, le sujet est dans le déni ou à tout le moins dans la dénégation (voire l’opposition caractérielle). - Au stade de contemplation ou intention (considération du changement), le sujet est ambivalent. Sa motivation à changer est fragile, autant dans le sens de maintenir le comportement que de le modifier. Le thérapeute ne peut avoir pour objectif que de travailler la balance décisionnelle (avantages et inconvénients à changer ou à maintenir le comportement).
- Au stade de préparation (prise de décision de changer), le sujet est prêt à changer. L’objectif du thérapeute est de baliser au mieux le plus court chemin vers le soin en proposant la solution la plus adaptée à sa demande.
- Au stade de l’action planifiée, inutile de chercher la motivation... elle est là. L’objectif est d’aider le sujet à maintenir son comportement modifié, de l’aider à identifier et utiliser les stratégies de prévention de la rechute.
- Au stade de consolidation (maintien de l’action planifiée menant à une guérison durable), le sujet est dans le maintien de nouveaux comportements et l’objectif est de renforcer les stratégies acquises et de prévenir la rechute.
- Enfin, intégrer la rechute comme stade de changement fut très judicieux de la part des concepteurs. C’est rappeler au patient (et au soignant) que le chemin peut être semé d’embûches, embûches liées au fait que l’addiction est une maladie chronique et récidivante. Ce n’est ni un problème moral, ni un fléau social, c’est une maladie du cerveau (Volkow, 2004) à la fois psychiatrique, neurobiologique et environnementale. Lors d’une rechute, c’est le moment de l’intégrer dans le processus de changement, de reprendre un travail de balance décisionnelle et d’éviter la paralysie de l’action liée à la culpabilité. La prescrire dans certaines situations peut même être paradoxalement salutaire. Toutefois, l’approche motivationnelle n’aborde pas l’existence d’une contrainte explicite ou implicite aux soins addictologiques. Un élément longtemps considéré comme un facteur limitant, dont nous avons fait au contraire un efficace levier de changement (Doutrelugne et Cottencin, 2011) dans le cadre des patients hospitalisés dans leur consentement.
La contrainte peut-elle être une motivation suffisante pour engager des soins ?
Selon les théories motivationnelles, les pressions externes diminuent la motivation interne, ce que l’on retrouve généralement dans les études (Simoneau, 2003). Toutefois nous savons aujourd’hui que c’est l’impact de la relation avec le thérapeute qui constitue l’élément clef de la motivation, qu’il y ait pression externe ou non. La motivation initiale, à tort définie comme une caractéristique stable du client, ne prédit pas la persévérance dans le traitement (Miller, 1985). Mais conceptualiser la motivation comme le produit d’échanges interpersonnels (Miller & Sanchez, 1994) entre le patient et le thérapeute est une évolution en parfait accord avec l’observation clinique. Ainsi pour le patient la vraie question est de savoir comment faire sienne la décision des autres. Car la situation la plus classique est une demande d’aide formulée sur pression de l’entourage par un patient en situation de crise, se considérant désigné par d’autres et pour un problème qu’il ne s’attribue pas mais qu’il attribue aux autres. Et s’il se plaint c’est plus souvent en raison des entraves que lui mettent les autres en lui imposant de se soigner alors qu’il ne se considère pas malade. C’est ainsi que nous avons longtemps considéré que les patients contraints n’étaient pas motivés. Alors qu’en réalité, ces patients sont motivés, mais pas sur les problèmes définis par les envoyeurs. En premier lieu, ils sont d’abord motivés à échapper à la contrainte. Et c’est la raison pour laquelle un soignant qui veut convaincre un patient contraint d’arrêter une addiction se range de facto à ses yeux du côté de la coercition. Il perd donc toute légitimité à communiquer puisqu’il n’est que le représentant de la contrainte. Si l’on veut pouvoir communiquer avec un patient contraint, il est inutile de chercher à le convaincre que l’envoyeur a raison de le contraindre. La contrainte est un fait... et il faut faire avec. Donc la question ici posée au soignant est de trouver le meilleur moyen de communiquer avec un sujet contraint, d’engager la rencontre en respectant ses mécanismes de défense et de mettre en valeur ses capacités d’autodétermination. La meilleure méthode pour ce faire est de centrer son discours sur les faits et d’agir au nom du principe de réalité (Doutrelugne et Cottencin, 2011). Il est plus efficace de valider la contrainte sans autre forme d’analyse plutôt que de renchérir les étiquettes de l’envoyeur (alcoolique, toxicomane, psychopathe...) ou de tenter de faire alliance avec le patient (au détriment de la réalité factuelle du comportement qui a imposé l’obligation aux soins). Ainsi en pratique, lors d’un premier entretien addictologique un soignant doit répondre à deux questions. Demande-t-il de l’aide ? Estil contraint ? Car en se focalisant sur la contrainte comme motif de con - sultation, il sera plus facile de définir des objectifs thérapeutiques qui lui seront acceptables.
Comment créer des résistances ?
« Ce fut un grand pas en avant de découvrir qu’un individu pouvait résister au changement à cause de so n contexte familial. Une étape plus importante encore fut de découvrir que la résistance de la famille pouvait être due à la technique du thérapeute » (Jay Haley, 1976). Le patient contraint de suivre une thérapie qu’il n’aura pas délibérément choisie sera contraint de résister au changement en mettant en échec tout l’étalage d’aide que l’on pourrait lui offrir.
Pour lire la suite de l’article et commander ce Hors-Série n°15 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves
Pr OLIVIER COTTENCIN
Professeur des universités de Psychiatrie et d’Addictologie à la faculté de médecine de Lille et praticien hospitalier responsable du service d’Addictologie du CHU de Lille. Promoteur de l’approche systémique et brève du traitement des addictions, il dirige des recherches sur les facteurs de vulnérabilité et de protection à l’initiation et à l’auto-entretien des comportements addictifs avec ou sans substances et les moyens d’optimisation thérapeutique (pharmacologique, psychothérapeutique ou organisationnelle) et de prévention au sein de l’équipe Plasticity & SubjectivitY (PSY) du Laboratoire Inserm U-1172 Lille Neuroscience & Cognition Centre (LiNC). Président du Collège universitaire national des enseignants d’addictologie, il oeuvre pour le développement de la discipline addictologique dans les trois domaines du soin, de l’enseignement et de la recherche.
Commandez le Hors-Série Peurs et Phobies n°15 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves
Cet ouvrage de 228 pages permet de comprendre les contextes relationnels favorisant les peurs et les phobies. « Le thérapeute, souligne Julien Betbèze, rédacteur en chef, est invité à découvrir une clinique fine qui passe par la différenciation entre trauma et situation angoissante, entre angoisse d’anticipation sans trauma et angoisse d’anticipation post-traumatique. » Vera Likaj, coordinatrice de l’ouvrage, a pensé ce numéro dans une approche plurielle et collaborative : des outils différents, des sensibilités uniques dans des cliniques parfois bien singulières revisitant la peur avec des lunettes culturelles chaque fois nouvelles.
« J’invite le lecteur, nous dit-elle, à parcourir les articles avec l’œil de l’anthropologue, curieux et discret, s’émerveillant des différences qui viennent nourrir toutes nos rencontres thérapeutiques. »
Retrouvez les abstracts de la revue sur ce lien
Au sommaire :
- Editorial : Peurs et phobies. L’hypnose comme levier de changement. Julien Betbèze
- Editorial : Et l’insouciance dans tout ça ? Vera Likaj
- Peurs traumatiques, peurs anticipatoires. Eric Bardot
- Peurs et risques psychosociaux au travail. Maxime Bellego
- Phobies. Et autres peurs ancrées. Jean-Marc Benhaiem
- Angoisse et hypnose en gériatrie. Jérôme Bocquet
- La peur de soi dans le processus de guérison. Pascale Chami
- La contrainte comme levier de changement ? Olivier Cottencin
- Croyances et anxiété. Yves Doutrelugne
- Faire corps avec la peur. La clinique de l’étrange. Nathalie Lampole
- Du lâche au héros. Revenir doucement à soi-même. Vera Likaj
- La peur de la peur. Retrouver des sensations qui nous guident. Emmanuel Malphettes
- Thérapie brève des phobies. Courtes réflexions. Dominique Megglé
- Peurs à l’école. Emmanuelle Piquet
- L’hypnose, un outil de gestion des phobies. Que nous apprend la recherche ? Audrey Vanhaudenhuyse et Marie-Elisabeth Faymonville
- Addictions et anxiété. David Vergriete
Tous les Hors-Séries de la Revue sont commandables sur le site www.hypnose-therapie-breve.org
« J’invite le lecteur, nous dit-elle, à parcourir les articles avec l’œil de l’anthropologue, curieux et discret, s’émerveillant des différences qui viennent nourrir toutes nos rencontres thérapeutiques. »
Retrouvez les abstracts de la revue sur ce lien
Au sommaire :
- Editorial : Peurs et phobies. L’hypnose comme levier de changement. Julien Betbèze
- Editorial : Et l’insouciance dans tout ça ? Vera Likaj
- Peurs traumatiques, peurs anticipatoires. Eric Bardot
- Peurs et risques psychosociaux au travail. Maxime Bellego
- Phobies. Et autres peurs ancrées. Jean-Marc Benhaiem
- Angoisse et hypnose en gériatrie. Jérôme Bocquet
- La peur de soi dans le processus de guérison. Pascale Chami
- La contrainte comme levier de changement ? Olivier Cottencin
- Croyances et anxiété. Yves Doutrelugne
- Faire corps avec la peur. La clinique de l’étrange. Nathalie Lampole
- Du lâche au héros. Revenir doucement à soi-même. Vera Likaj
- La peur de la peur. Retrouver des sensations qui nous guident. Emmanuel Malphettes
- Thérapie brève des phobies. Courtes réflexions. Dominique Megglé
- Peurs à l’école. Emmanuelle Piquet
- L’hypnose, un outil de gestion des phobies. Que nous apprend la recherche ? Audrey Vanhaudenhuyse et Marie-Elisabeth Faymonville
- Addictions et anxiété. David Vergriete
Tous les Hors-Séries de la Revue sont commandables sur le site www.hypnose-therapie-breve.org