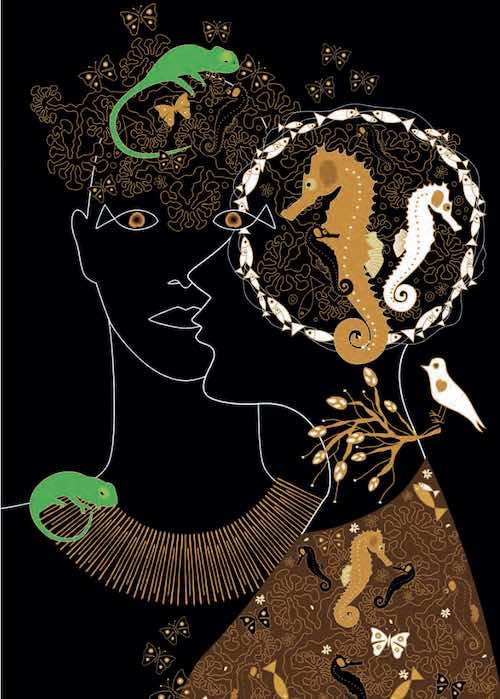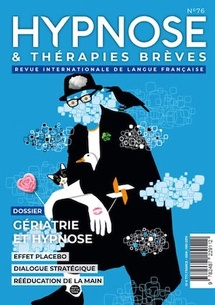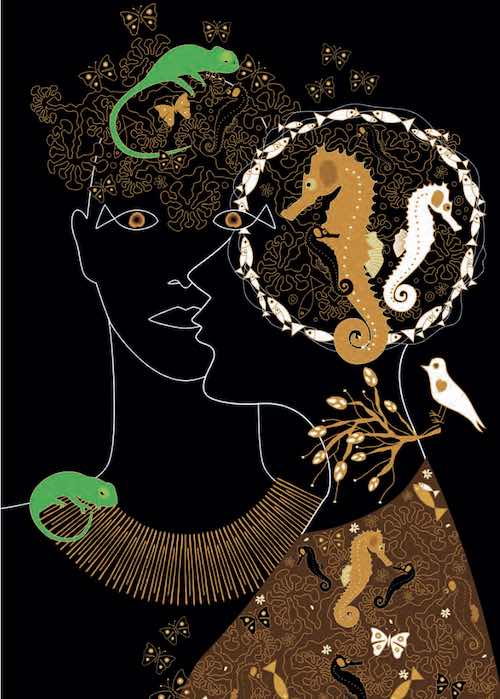
Une troupe de théâtre vient, sur la « Colline du savoir », à la rencontre d’un ou plusieurs patients hospitalisés, expliquent un psychiatre et un comédien engagés depuis des années dans une démarche thérapeutique singulière au Mali. Acteurs, chanteurs et musiciens se rassemblent autour de malades, accompagnés parfois de soignants, dans un lieu protégé, au sein de la section psychiatrique de l’hôpital de Bamako.
Dans une écoute qui est autre, usant avec douceur de chants et de proverbes, ils préparent une représentation qui sera jouée plus tard, à ciel ouvert, au centre de la structure hospitalière constituée en « village psychiatrique », sur une large place centrale bordée de différentes salles de consultation. Le kotéba thérapeutique, tel est le nom de cette approche, mettra en scène ainsi, au moyen de petites pièces chantées et jouées, de mimes, de saynètes comiques et burlesques, de déclamations parfois appuyées de proverbes connus ou encore de devinettes, les difficultés d’un patient telles qu’exprimées par celui-ci. Dans l’intimité du lieu, les malades racontent en effet parfois aux comédiens ce qu’ils ne disent pas aux médecins ou à leur famille, ou ce qu’il est impossible de dire dans la société.
Ainsi sont dévoilés problèmes relationnels, souffrances, possession, jalousie, abandon, malédiction ou mise à l’écart de la société... Les comédiens définissent alors les thèmes et les grandes lignes de ce qui sera joué sur la place centrale, sans décor et avec des accessoires rudimentaires. Rompus à cet exercice, ils utilisent, avec les médecins, les différentes étapes de ce théâtre pour entraîner le patient, sa famille et les soignants dans le jeu de scène. A l’appel du tambour annonçant l’imminence de la représentation, malades, personnels de soin, familles, visiteurs de l’hôpital approchent, certains se mettent à danser. Tous ceux qui le souhaitent assistent à ce jeu et peuvent y participer à leur guise. Les comédiens endossent certains rôles au sein de ce spectacle aux contours déterminés à l’avance qui laissent cependant la place à l’improvisation. Ces rôles sont récurrents et emblématiques : chef du village, resituant ainsi le patient dans un contexte défini, adjoint au chef du village, femme du chef de village et, selon les situations, mari volage, ivrogne, marabout, mère abandonnant ses enfants, sorcier, voleur... Le théâtre s’intéresse au présent.
Dans une situation au départ banale, les comédiens introduisent le problème apporté par le patient. Celui-ci participe à la scène, il joue, il danse, son corps est pris dans des relations presque oubliées par les gestes qui se déploient et par des contacts physiques inhérents au théâtre ; écouté, il occupe un autre rôle, se repositionne dans le tissu relationnel en jeu ; stimulé par les interactions qui se déploient, il trouve des solutions aux difficultés jouées grâce à ce qui est proposé dans la représentation, à quelques mimes ou proverbes énoncés. Il est encore porté par les réactions du public qui devient cothérapeute, au même titre que le sont les comédiens, les malades qui se joignent à la pièce spontanément, les équipes de soin ou les familles présentes. Et surtout on rit de ces saynètes au ressort comique, de ces farces parfois grotesques.
Cette approche, mise en place il y a une cinquantaine d’années dans l’hôpital, prend en charge les patients qui étaient délaissés, isolés dans leur pathologie. Elle est inspirée du théâtre traditionnel profane du même nom, le kotéba, joué il y a encore quelque temps dans les villages et dont l’origine se situe dans le Pays bambara. Ce théâtre, représenté au moins une fois par an, avait pour particularité, selon les spécialistes, de réguler les tensions et de renforcer la cohésion sociale au sein des communautés.
Pour lire la suite...
Dans une écoute qui est autre, usant avec douceur de chants et de proverbes, ils préparent une représentation qui sera jouée plus tard, à ciel ouvert, au centre de la structure hospitalière constituée en « village psychiatrique », sur une large place centrale bordée de différentes salles de consultation. Le kotéba thérapeutique, tel est le nom de cette approche, mettra en scène ainsi, au moyen de petites pièces chantées et jouées, de mimes, de saynètes comiques et burlesques, de déclamations parfois appuyées de proverbes connus ou encore de devinettes, les difficultés d’un patient telles qu’exprimées par celui-ci. Dans l’intimité du lieu, les malades racontent en effet parfois aux comédiens ce qu’ils ne disent pas aux médecins ou à leur famille, ou ce qu’il est impossible de dire dans la société.
Ainsi sont dévoilés problèmes relationnels, souffrances, possession, jalousie, abandon, malédiction ou mise à l’écart de la société... Les comédiens définissent alors les thèmes et les grandes lignes de ce qui sera joué sur la place centrale, sans décor et avec des accessoires rudimentaires. Rompus à cet exercice, ils utilisent, avec les médecins, les différentes étapes de ce théâtre pour entraîner le patient, sa famille et les soignants dans le jeu de scène. A l’appel du tambour annonçant l’imminence de la représentation, malades, personnels de soin, familles, visiteurs de l’hôpital approchent, certains se mettent à danser. Tous ceux qui le souhaitent assistent à ce jeu et peuvent y participer à leur guise. Les comédiens endossent certains rôles au sein de ce spectacle aux contours déterminés à l’avance qui laissent cependant la place à l’improvisation. Ces rôles sont récurrents et emblématiques : chef du village, resituant ainsi le patient dans un contexte défini, adjoint au chef du village, femme du chef de village et, selon les situations, mari volage, ivrogne, marabout, mère abandonnant ses enfants, sorcier, voleur... Le théâtre s’intéresse au présent.
Dans une situation au départ banale, les comédiens introduisent le problème apporté par le patient. Celui-ci participe à la scène, il joue, il danse, son corps est pris dans des relations presque oubliées par les gestes qui se déploient et par des contacts physiques inhérents au théâtre ; écouté, il occupe un autre rôle, se repositionne dans le tissu relationnel en jeu ; stimulé par les interactions qui se déploient, il trouve des solutions aux difficultés jouées grâce à ce qui est proposé dans la représentation, à quelques mimes ou proverbes énoncés. Il est encore porté par les réactions du public qui devient cothérapeute, au même titre que le sont les comédiens, les malades qui se joignent à la pièce spontanément, les équipes de soin ou les familles présentes. Et surtout on rit de ces saynètes au ressort comique, de ces farces parfois grotesques.
Cette approche, mise en place il y a une cinquantaine d’années dans l’hôpital, prend en charge les patients qui étaient délaissés, isolés dans leur pathologie. Elle est inspirée du théâtre traditionnel profane du même nom, le kotéba, joué il y a encore quelque temps dans les villages et dont l’origine se situe dans le Pays bambara. Ce théâtre, représenté au moins une fois par an, avait pour particularité, selon les spécialistes, de réguler les tensions et de renforcer la cohésion sociale au sein des communautés.
Pour lire la suite...
Dr Sylvie LE PELLETIER-BEAUFOND
Médecin-psychothérapeute depuis 1991, hypnothérapeute, thérapeute systémique de famille et de couple, à Paris en libéral. Formatrice, elle reçoit des professionnels en supervision. Formée à l’Institut Milton Erickson de Paris et par Mony Elkaïm, sa pratique clinique s’inspire de la pensée de François Roustang. Membre de la Société française de Thérapie familiale. Anthropologue des religions et diplômée de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°76 version Papier
N°76 : Fév. / Mars / Avril 2025
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Crédit photo: Caroline Berthet
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Crédit photo: Caroline Berthet